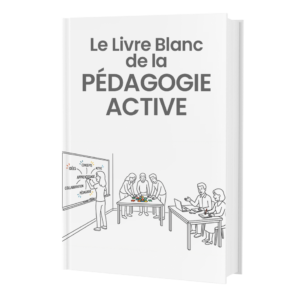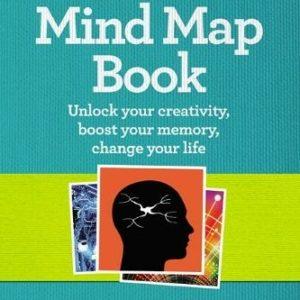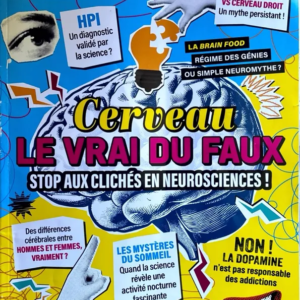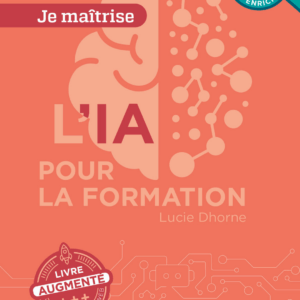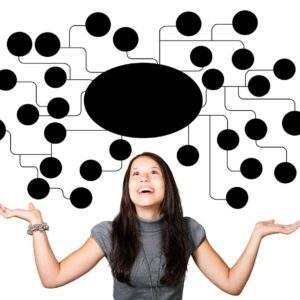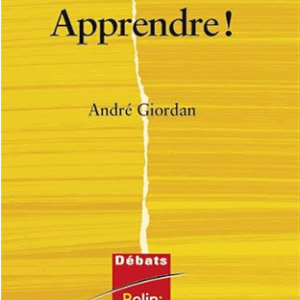
Par Carlo BIANCHI : Consultant en Ingénierie Pédagogique & Concepteur de Jeux de Formation
La formation interne est un parcours professionnel réalisé en entreprise, visant le développement des compétences des collaborateurs, conformément à l’article L6313-1 du Code du Travail. »
Faire appel aux experts métier pour animer des formations en interne représente plusieurs avantages :
- Diffusion de savoirs uniques, non disponibles sur le marché.
- Mise en œuvre de l’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail).
- Crédibilité accrue grâce à l’expérience professionnelle.
- Alignement avec la culture d’entreprise.
- Rapidité d’appropriation des compétences.
- Maîtrise des coûts et de l’organisation.
- Valorisation du personnel interne.
- Renforcement du lien entre managers et équipes.
- …
Si les avantages de la formation interne sont multiples, la mise en oeuvre efficace et la pérennisation des résultats dépendent de l’approche pédagogique et des moyens mis à disposition des formateurs.
Les difficultés du formateur autodidacte
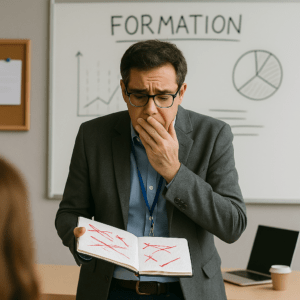 Il nous arrive de rencontrer des experts métier ayant un vrai talent naturel pour transmettre et animer efficacement, mais ils restent l’exception. Dans la majorité des cas, même si les questionnaires de satisfaction à chaud sont flatteurs, les résultats observés à moyen ou long terme restent en deçà des attentes.
Il nous arrive de rencontrer des experts métier ayant un vrai talent naturel pour transmettre et animer efficacement, mais ils restent l’exception. Dans la majorité des cas, même si les questionnaires de satisfaction à chaud sont flatteurs, les résultats observés à moyen ou long terme restent en deçà des attentes.
Il suffit d’assister à une session, ou d’analyser les supports d’animation, pour constater les erreurs classiques du formateur autodidacte. Des erreurs prévisibles, souvent répétées, et malheureusement pas réservées aux seuls débutants…
En voici quelques-unes parmi les plus fréquentes, qui illustrent l’intérêt d’un accompagnement spécifique.
1. Une posture trop prescriptive
L’expert a naturellement tendance à adopter une posture descendante : « Faites ceci, évitez cela », en s’appuyant sur son propre vécu ou ses méthodes personnelles. C’est un réflexe compréhensible, qui repose sur une volonté d’efficacité et de transmission directe. Mais il oublie une réalité essentielle : ce n’est pas parce qu’une méthode fonctionne pour un spécialiste qu’elle est automatiquement transférable ou compréhensible pour l’apprenant.
Le formateur, lui, part des besoins et du niveau des apprenants pour construire un apprentissage progressif, contextualisé et accessible. Il ne dit pas ce qu’il sait faire – il fait en sorte que les apprenants apprennent ce qu’ils doivent faire !
2. Des anecdotes mal calibrées
Partager des expériences professionnelles rend une formation vivante et plus crédible, mais encore faut-il que ces anecdotes servent un objectif pédagogique clair. Trop souvent, elles dérivent en récits personnels, déconnectés des préoccupations des participants.
Le risque : perdre l’attention, brouiller les messages essentiels, et noyer l’apprentissage dans un excès de détails. Une anecdote bien choisie doit illustrer un concept, éveiller une question ou provoquer une prise de conscience. Sinon, elle n’est qu’un moment agréable… sans impact réel sur l’apprentissage.
3. Une surcharge cognitive
Quand l’expert veut bien faire, souvent il en dit trop. Il empile les informations, détaille toutes les exceptions, fournit en peu de temps une avalanche d’exemples (timing oblige).
Résultat : les apprenants saturent. C’est ce qu’on appelle la surcharge cognitive. Notre cerveau ne peut traiter qu’un volume limité d’informations à la fois.
Le bon formateur fait attention à ne pas trop en donner : il sait faire des choix, simplifier sans appauvrir, structurer et hiérarchiser l’information pour en faciliter la mémorisation.
4. Des supports par toujours bien conçus
Les supports réalisés par les formateurs autodidactes sont souvent denses, peu aérés, et surtout pensés comme des documents à lire.
Résultat : des slides surchargées, des tableaux indigestes, peu de visuels.
Un support de formation n’est pas un manuel technique. Il doit accompagner la parole du formateur, clarifier les idées clés et faciliter l’attention. L’ergonomie (lisibilité, hiérarchie visuelle, cohérence graphique) est un levier puissant de compréhension et de mémorisation (cf. 12 principes du Dr. Mayer).
5. Une évaluation réduite au ressenti
Évaluer ne veut pas dire : participants contents = formation réussie.
Les questionnaires de satisfaction à chaux ne mesurent qu’une opinion immédiate, pas le niveau d’apprentissage. Sans indicateurs définis au préalable il est impossible de savoir si les objectifs pédagogiques sont atteints.
Le formateur doit penser son évaluation en amont, comme un outil d’alignement entre objectifs, contenu et animation (d’où l’intérêt d’une scénarisation de la formation, rédigée TOUJOURS avant la production des supports d’animation).
6. Peu ou pas d’interactivité
Enfin, beaucoup d’experts continuent à animer en mode conférence, convaincus que leur expertise suffit à capter l’attention.
Résultat : des formations linéaires, descendantes, sans dynamique de groupe ni engagement actif des participants. Pourtant, les neurosciences sont formelles : on apprend en faisant, en discutant, en se trompant, en reformulant.
L’interactivité (questionnements, exercices, jeux, études de cas) n’est pas une option décorative : c’est une nécessité.
Se former pour mieux former 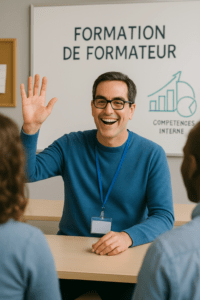
Transformer une expertise en une formation efficace nécessite une formation spécifique, destinée à développer les compétences clés du formateur interne. Cette montée en compétence permet d’acquérir :
- Les fondamentaux de l’apprentissage des adultes.
- Les techniques de conception pédagogique (analyse des besoins, scénarisation, instrumentation, production des supports).
- Les compétences d’animation et de posture (gestion de groupe, écoute active, adaptation).
- Les méthodes d’évaluation (diagnostique, formative, sommative, à chaud et à froid).
Concevoir des modules engageants : un travail de fond
Créer une formation efficace ne se résume pas à transmettre du contenu. Cela implique de :
- Structurer les apprentissages de manière progressive, rythmer et articuler les séquences.
- Adapter les messages au public et à la culture d’entreprise,
- Imaginer des activités interactives (études de cas, mises en situation, quiz, simulations…).
- Anticiper les freins à l’appropriation des savoirs.
- Intégrer des dispositifs d’évaluation pertinents.
De la posture d’expert prescripteur à celle de formateur facilitateur
Le rôle du formateur consiste, entre autres, à formaliser les savoirs, à structurer l’apprentissage, et à guider les apprenants vers une compréhension profonde.
Au-delà de la posture d’expert, selon les objectifs qui lui sont confiés par l’entreprise, trois autres postures fondamentales sont souvent mobilisées :
- Facilitateur : stimule l’échange et l’autonomie des apprenants.
- Animateur : motive et encourage.
- Tuteur/Coach : écoute, adapte, et accompagne la mise en pratique des acquis de la formation.
La posture idéale est souvent hybride : on alterne entre ces registres selon les objectifs, la situation et les profils des apprenants.
D’une manière générale, une formation réussie repose sur des méthodes pédagogiques éprouvées, des supports variés, une progression structurée, et un cadre d’évaluation clair.
Apprendre… et expérimenter sur le terrain
On ne forme pas efficacement des professionnels en se contentant de leur faire écouter ou observer. L’apprentissage des adultes repose avant tout sur l’expérimentation. Pour apprendre durablement, les adultes ont besoin de :
- Pratiquer.
- Tester, se tromper, recommencer.
- Recevoir des retours personnalisés.
- Transposer ces apprentissages à leur réalité terrain.
La formation ne s’arrête donc pas à la salle ou à l’écran : elle se prolonge dans l’action, sur le poste de travail. C’est dans ce contexte opérationnel que les apprentissages prennent tout leur sens, à travers le transfert concret des acquis et leur consolidation dans la durée.
Cette phase d’ancrage, souvent négligée, est pourtant essentielle pour garantir l’efficacité de la formation. Comme le rappelle Philippe Carré, spécialiste de la formation des adultes, « on n’apprend pas pour savoir, mais pour agir ». Le véritable enjeu est donc de permettre l’application des savoirs en situation réelle.
Reste à savoir si l’entreprise souhaite confier cette mission au formateur interne. Si tel est le cas, elle doit organiser cette responsabilité dans un cadre clair, en lien étroit avec les managers de proximité, garants de l’environnement de travail et du suivi opérationnel.
Concrètement, si le formateur interne accompagne la montée en compétence des collaborateurs, de la définition du besoin jusqu’à la validation des acquis, voire la concrétisation des résultats opérationnels, c’est donc un métier à part entière, qui s’ajoute au métier de base !
Le temps, un maillon faible 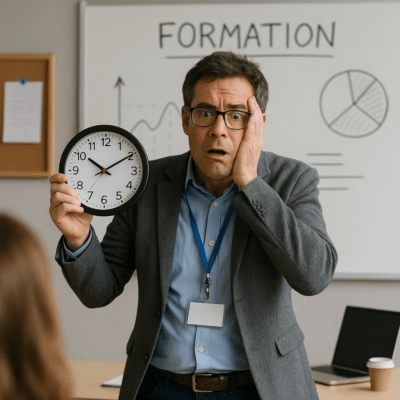
Dans un contexte où les entreprises sont soumises à des impératifs de performance toujours plus exigeants, le temps devient une ressource critique. Or, vouloir « tout transmettre en un minimum de temps » est une illusion contre-productive.
Il faut accepter que la montée en compétence s’inscrive dans une temporalité réaliste et progressive :
- du temps pour concevoir des formations de qualité,
- du temps pour permettre aux apprenants de se former, pratiquer et intégrer,
- du temps pour que les résultats se traduisent en impacts opérationnels.
Investir dans la durée, c’est considérer la formation interne non comme un coût, mais comme un véritable levier stratégique.
Cependant, confier une mission de formation à un expert métier ne doit pas se faire au détriment de son activité principale. Il est essentiel d’éviter toute surcharge de travail qui risquerait de nuire à la fois à son efficacité opérationnelle et à la qualité de la formation.
Soyons lucides : il ne s’agit pas de transformer un professionnel en ingénieur pédagogique ou en spécialiste de la gestion des compétences.
C’est pourquoi une formation de formateurs internes doit être pensée en tenant compte de cette réalité. Elle doit leur permettre de trouver un équilibre entre professionnalisme pédagogique et contraintes de productivité. L’objectif est de leur fournir des méthodes simples, agiles et immédiatement opérationnelles, sans alourdir leur quotidien.
À ce titre, certaines approches pédagogiques s’avèrent particulièrement adaptées. C’est le cas des Frame Games (jeux cadre), popularisés par Sivasailam Thiagarajan (plus connu sous le nom de Thiagi) qui résume avec humour sa philosophie par la formule provocatrice « un bon formateur est un formateur paresseux ». Derrière cette boutade, il défend l’idée qu’avec les bons outils, il est possible de concevoir des dispositifs ludiques, engageants et prêts à l’emploi, sans y consacrer des journées entières.
Autre exemple : la méthode dite « zéro slides », qui propose réduire au minimum les présentations PowerPoint au profit d’un fil conducteur basé sur le mindmapping (carte mentale), et d’outils visuels tels que posters, paperboards ou ateliers collaboratifs avec des post-it.
Ces démarches favorisent une transmission interactive des contenus tout en facilitant la conception rapide de supports pédagogiques attractifs, peu coûteux et facilement réutilisables.
Former les formateurs internes, c’est donc aussi leur apprendre à faire simple, sans faire simpliste.
Le formateur 2.0 face aux défis numériques 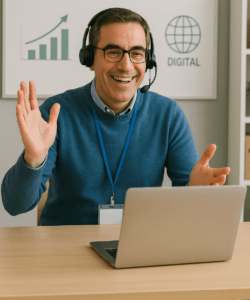
Un tournant structurel
La crise sanitaire a accéléré le recours massif à la formation à distance.
Aujourd’hui, le blended learning (ou formation hybride), combinant présentiel, visio et modules e-learning, s’impose comme le modèle dominant.
Initialement perçu comme une réponse d’urgence, le digital s’est installé durablement dans les pratiques.
Les formateurs ne peuvent plus se contenter de traduire en numérique leurs modules présentiels : ils doivent également apprendre à concevoir et animer des parcours pensés pour l’hybride.
Être formateur 2.0 suppose une pratique aisée des plateformes LMS, des outils collaboratifs et de classe virtuelle.